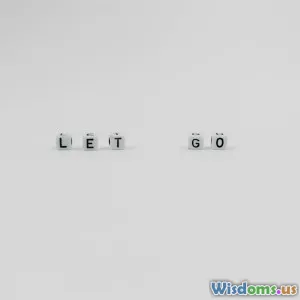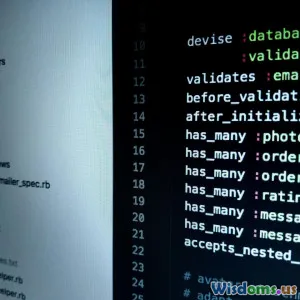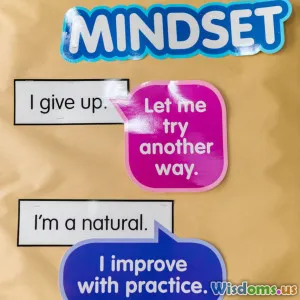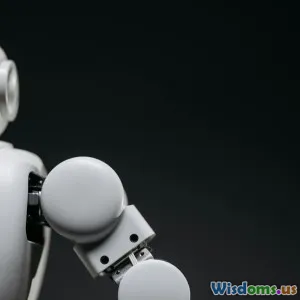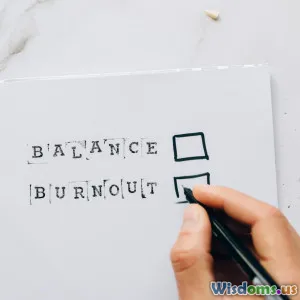Les mythes sur la résilience qui pourraient vous freiner
(Myths About Resilience That May Be Holding You Back)
18 minute lu Découvrez la vérité sur les mythes courants entourant la résilience et la façon dont ils peuvent entraver la croissance personnelle et la récupération. (0 Avis)
Mythes sur la résilience qui pourraient vous freiner
La résilience est souvent présentée comme l'antidote à l'adversité — une source mystérieuse qui pousse certaines personnes à rebondir après des revers, tandis que d'autres chancellent. Pourtant, l'image de la résilience popularisée dans les livres d'auto-assistance et les affiches motivationnelles cache des vérités plus profondes et des idées reçues qui peuvent, sans le vouloir, étouffer la vraie croissance. De nombreux mythes sur la résilience persistent, colorant nos attentes, nos jugements sur nous-mêmes et nos stratégies.
Démêlons quelques-unes des conceptions les plus répandues — et limitantes — sur la résilience, et explorons des points de vue plus habilitantes qui peuvent vous aider à développer une véritable force et une capacité d'adaptation.
Le mythe : On naît résilient ou on ne l’est pas

L’un des mythes les plus tenaces présente la résilience comme un trait inhérent, une sorte d’ADN psychologique codé à la naissance. Si vous n’avez pas été élevé avec dureté ou bénis par des « gènes de la ténacité », on pense que vous êtes destiné à lutter.
Mais la science raconte une autre histoire.
Bien que les recherches montrent que le tempérament et les facteurs génétiques influencent la façon dont nous réagissons au stress, des études en psychologie du développement, telles que celles d’Emmy Werner et de Boris Cyrulnik, concluent que la résilience est largement façonnée par les expériences de vie et l’environnement. Même celles et ceux qui font face à des défis, comme l’adversité pendant l’enfance, peuvent devenir incroyablement résilients avec le bon soutien et les circonstances appropriées.
Exemple : Considérez J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter en tant que mère célibataire luttant sur le plan économique. Elle attribue ouvertement non pas à une ténacité innée, mais à des personnes de soutien et à un travail porteur de sens qui l'ont aidée à persévérer face à la difficulté.
Aperçu actionnable : Plutôt que de croire que vous l’avez ou non, commencez à considérer la résilience comme une capacité — qui se développe avec une pratique délibérée, du mentorat, des retours positifs et l’apprentissage à partir des revers.
Le mythe : Les personnes résilientes ne craquent jamais

La culture populaire décrit fréquemment les individus résilients comme imperturbables : ils affrontent chaque crise les yeux fixes, sans jamais laisser voir des larmes ou de l’anxiété. Ce mythe non seulement déforme la réalité de la force intérieure mais crée aussi une stigmatisation autour de la vulnérabilité.
La vérité ? Même les personnes les plus résilientes traversent des moments difficiles — parfois spectaculaires.
-
L’honnêteté émotionnelle est un ingrédient crucial de la résilience. Les recherches de Brené Brown soulignent que la reconnaissance ouverte de la douleur, la peur et la tristesse ne signalent pas une faiblesse ; au contraire, une telle vulnérabilité constitue le socle du rétablissement personnel et d'une adaptation saine.
-
La croissance post-traumatique souligne en outre que nombre de ceux qui affichent finalement une résilience marquante éprouvent d'abord une détresse profonde, du chagrin, voire des effondrements. La résilience n’est pas l’absence de douleur, mais la navigation et l’intégration éventuelle de ces expériences.
Note du monde réel : Le tardif Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Ses journaux révèlent des moments de désespoir et d’auto-doute, mais ces aveux ont nourri plutôt qu’ils n’ont menacé sa force future.
En résumé : Ne mesurez pas votre résilience à la manière dont vous parvenez à paraître stoïque. Vous accorder la permission de ressentir et de guérir accélère votre retour à l’équilibre, et non le retarde.
Le mythe : La résilience signifie maintenir une attitude toujours positive
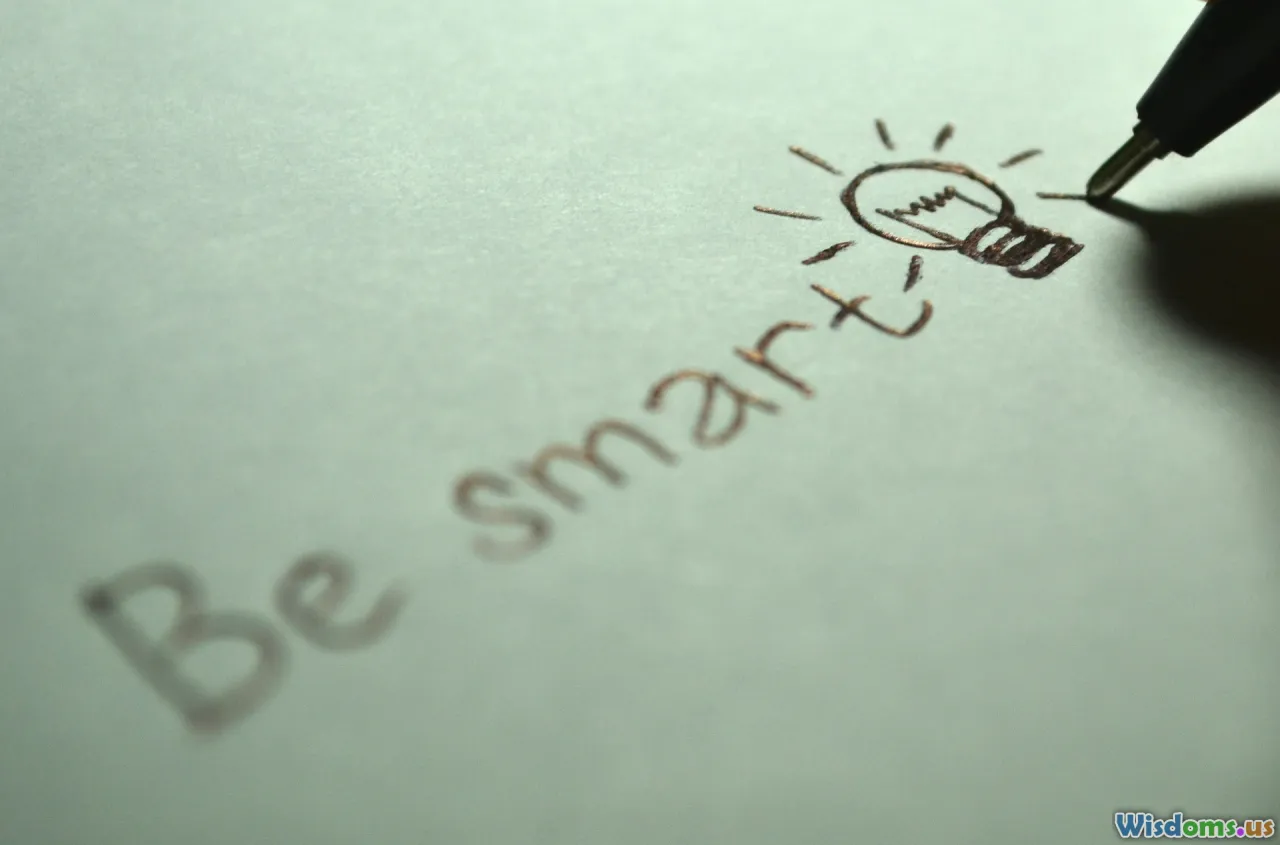
Les clichés tels que « regardez le bon côté des choses » et « que des ondes positives » suggèrent que l’optimisme est un état d’esprit inébranlable chez les personnes résilientes. Mais une positivité imposée peut en réalité se retourner contre vous.
-
La positivité toxique peut supprimer les émotions authentiques et empêcher les gens de traiter les vrais revers. Comme l’explique la psychologue Susan David, nier l’inconfort (« Je vais bien ! » quand ce n’est pas le cas) ne génère pas de résilience, mais de l’évitement et des mécanismes de coping superficiels.
-
L’authentique résilience vient d’un optimisme réaliste — la capacité à reconnaître les problèmes honnêtement, à accueillir des émotions complexes, puis à trouver du sens ou des solutions constructives.
Cas concret : Après avoir subi des brûlures sur 65 % de son corps, le conférencier John O’Leary a appris que l’expression de ses peurs et frustrations honnêtes accélère la guérison physique — et psychologique. Faire semblant d’être positif n’a pas aidé.
Astuce : Autorisez à toutes les émotions, positives comme négatives, de trouver leur place. Puis, entraînez-vous à rediriger l’attention vers les valeurs, les solutions et les leçons sans nier la réalité.
Le mythe : La résilience signifie le faire seul

Une autre idée reçue répandue présente la résilience comme une entreprise solitaire, obtenue uniquement par la volonté. Dans ce récit, l’indépendance est reine.
Mais les données contredisent cet idéal.
- De nombreuses études psychologiques (comme les travaux de Michael Ungar sur la résilience chez les jeunes) montrent que le soutien social est le prédicteur unique le plus important d'une résilience durable.
- Appartenir à des familles, des équipes, des églises ou des communautés en ligne peut atténuer le stress et renforcer l’adaptabilité — même si les mécanismes d’adaptation initiaux échouent.
Exemple pratique : Lorsque les astronautes opèrent dans des environnements à haut risque comme la Station spatiale internationale, le soutien du contrôle au sol et l’expertise partagée par l’ensemble de l’équipage sont essentiels pour gérer les crises. La NASA investit massivement non seulement dans la formation technique mais aussi dans la « résilience collective ».
Conseil : Cultivez votre réseau de soutien, entraînez-vous à demander (et à offrir) de l’aide, et reconnaissez que vos plus grandes avancées émergent généralement au sein de réseaux de confiance et de coopération. La connexion sociale n’est pas un signe de faiblesse personnelle — c’est une ancre stratégique.
Le mythe : Des solutions rapides ou des solutions uniques construisent la résilience

Les annonceurs et les modes d’auto-assistance présentent souvent la résilience comme un produit : assister à un séminaire, télécharger une application de méditation, réciter un ensemble d’affirmations — presto, vous devenez résilient.
Pourtant, la résilience durable est un processus dynamique — et non une acquisition unique.
- Construire la résilience implique une combinaison d’attitudes (opposant les mentalités fixes et de croissance), des soins personnels constants, des habitudes et la volonté d’apprendre et de s’adapter au fil du temps.
- Les interventions doivent être continues et adaptées au contexte ; ce qui fonctionne pour une source de stress (par exemple, parler en public) peut ne pas se transposer à une autre (deuil, burn-out au travail, maladie chronique).
Exemple : Pensez à des athlètes en rééducation après une blessure grave. Leur retour à une performance optimale n’est que rarement linéaire ou rapide ; il est affiné et rétoûlé par des échecs répétés, de nouvelles stratégies et des ajustements continus.
Comment faire : Plutôt que de chercher des solutions miracles, abordez le développement de la résilience comme un long jeu. Expérimentez avec la pleine conscience, l’écriture, la thérapie, la condition physique et l’apprentissage continu pour créer une boîte à outils que vous adapterez au cours de votre vie.
Le mythe : Les échecs passés vous disqualifient quant à votre résilience

Certaines personnes internalisent les luttes comme des preuves qu’elles « ne sont tout simplement pas résilientes ». Cette auto-critique survient souvent après des projets qui échouent, des revers relationnels ou l’incapacité à faire face comme elles l’espèrent.
Mais échouer — parfois à répétition — ne signifie pas que vous manquez de résilience.
- L’échec est inhérent à la croissance. Selon les recherches de Dr Carol Dweck sur l’état d’esprit de croissance, les revers ne prouvent pas l’incapacité mais servent de tremplins pour de nouvelles stratégies et l’apprentissage.
- En fait, ceux qui réfléchissent à leurs erreurs passées — sans une autocritique excessive — ont tendance à développer une plus grande confiance et une plus grande flexibilité pour l’avenir.
Histoire célèbre : Abraham Lincoln a échoué dans les affaires, a perdu plusieurs élections politiques et a connu des épisodes de dépression avant de devenir président des États-Unis. Chaque revers a contribué à sa persévérance légendaire.
Étape actionnable : Reformulez vos revers comme preuves que vous êtes engagé dans la vie et dans l’apprentissage. Puisez dans votre expérience des perspectives pour l’avenir plutôt que des preuves d’incapacité.
Le mythe : N’importe qui peut « maîtriser la résilience » sans aide professionnelle

Alors que de nombreux aspects de la résilience sont accessibles par un apprentissage autonome, ce mythe décourage les gens de chercher un soutien professionnel ou des ressources en santé mentale. Certains assimilent même le fait de demander de l’aide à un manque de robustesse.
En réalité, l’aide professionnelle est souvent essentielle au développement de la résilience, particulièrement après un traumatisme, face à une dépression persistante ou à l’anxiété.
- Les thérapeutes, les coachs et les groupes de soutien offrent des stratégies basées sur des preuves et des retours objectifs indisponibles par l’effort solitaire.
- Une intervention précoce peut rapidement rediriger les stratégies d’adaptation avant l’apparition d’habitudes destructrices.
Note du monde réel : Après des catastrophes naturelles, ceux qui font appel à des professionnels de la santé mentale rapportent non seulement une stabilisation émotionnelle plus rapide, mais aussi une adaptation à long terme accrue, selon des études de l’American Psychological Association.
Astuce : Utilisez les ressources professionnelles comme un outil dans votre trousse à outils de résilience. Il n’y a pas de perte de dignité à tirer parti de l’expertise et des idées que les autres offrent ; cela amplifie — et non diminue — votre capacité.
Le mythe : La résilience signifie endurer tout indéfiniment

Cette idée reçue présente la résilience comme une endurance sans fin : affronter toute forme d’abus, d’injustice, ou d’adversité avec une patience permanente.
Mais en réalité, savoir quand ne pas endurer est une forme profonde de résilience.
- Fixer des limites et dire « assez » préserve l’endurance pour les combats qui comptent.
- La surexposition à des environnements toxiques continus (comme des lieux de travail abusifs ou des relations dangereuses) peut causer des dommages durables, peu importe la force de ses mécanismes d’adaptation.
Exemple : Simone Biles, la gymnaste olympique, s’est retirée des finales des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 pour protéger sa santé mentale — démontrant que la véritable résilience consiste souvent à privilégier les soins personnels plutôt que les attentes extérieures.
Comment faire : Réévaluez régulièrement vos engagements et vos facteurs de stress. Reconnaissez que faire une pause, quitter une situation nuisible ou rechercher justice n’est pas abandonner ; c’est un acte d’estime de soi et de préservation de votre bien-être pour l’avenir.
Repenser la résilience pour une vraie croissance

Le chemin vers une résilience authentique ne ressemble en rien à l’image mythique d’un héros solitaire, éternellement optimiste. Il est plus chaotique, plus relationnel, construit à travers des cycles de stress et de guérison, de succès et de revers. Le don de démystifier ces croyances est de nous offrir une nouvelle latitude pour expérimenter, lutter honnêtement et accéder à des ressources plus larges — communauté, outils, soutien et autocompassion.
La vraie résilience est dynamique et personnelle. En laissant de côté les légendes limitatives et en adoptant des stratégies fondées sur des preuves et une réflexion honnête, vous libérez votre potentiel d’adaptation et de croissance significatives — prêt(e) à ce que la vie vous réserve ensuite.
Évaluer la publication
Avis des utilisateurs
Autres publications dans Santé Mentale
Publications populaires